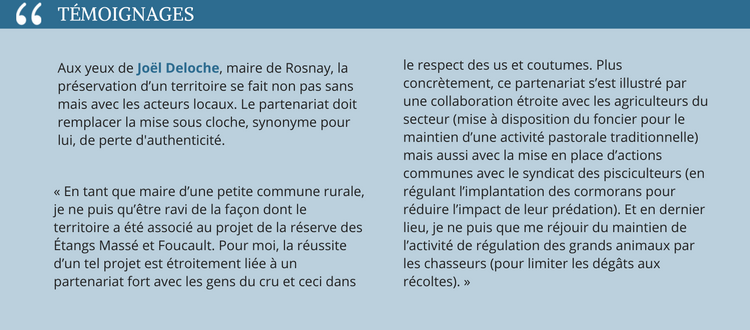Accepter les réalités territoriales
Espaces naturels n°57 - janvier 2017
Frédéric Breton,
directeur du Cen Centre-Val de Loire.
Avec la vraie volonté d'écouter tous les points de vue, même ceux qui nous dérangent, on arrive à avancer. Les gestionnaires de la RNR des terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault se sont attachés à garder un lien constant avec le territoire, sans fuir la discussion. Ils y ont gagné un très large consensus positif autour de la création de cet espace protégé.

La création de la Réserve naturelle régionale des terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault, peut être considérée comme le résultat d’un processus de longue haleine dans lequel l’implication des acteurs et les relations humaines de confiance
tissées au fil des interventions ont joué un rôle majeur. Même si ce classement n’était pas l’ambition initiale, celle-ci étant d’abord de préserver le patrimoine naturel Brennou, une RNR, tant à travers le processus de concertation préalable à sa création que par le fonctionnement ultérieur, permet de mettre l’ensemble des acteurs du territoire autour du projet et représente un label qui est susceptible de renforcer l’attractivité du territoire.
En amont de la création de la réserve, le montage d'un dispositif de protection à la fois foncier et réglementaire a permis de tisser des liens solides et durables (7 ans) avec certains acteurs du territoire.
Par exemple, entre 1995 et 1999, un dispositif assez innovant en ce sens qu’il associait les propriétaires privés, la Fédération départementale des chasseurs de l’Indre, la LPO, le WWF-France et le PNR de la Brenne, a été mis en place en vue d’assurer la quiétude des espèces d’oiseaux en y créant une réserve de chasse et de faune sauvage. Des opérations de gestion des milieux et d’ouverture au public ont également été conduites. En 2011, un propriétaire a souhaité vendre 184 ha. Très attaché à la préservation de la biodiversité, il s’est spontanément tourné vers le PNR Brenne, avec qui des relations régulières avaient été maintenues. Le rôle du notaire est également à souligner. Celui-ci étant très attaché à la préservation de l’identité paysagère de Brenne, il a eu à coeur d’éviter de démembrer la propriété pour la vendre en plusieurs parties, ce qui lui aurait pourtant été facile et certainement plus lucratif. Le processus d’acquisition, porté par le Cen Centre-Val de Loire, a ensuite été facilité par un partenariat constructif avec la SAFER qui a mis en place les procédures ayant évité de voir émerger des candidatures concurrentes.

De fait, une acquisition foncière ne résulte pas d’une mécanique financière et juridique froide mais bien d’un processus dans lequel les relations humaines sont au coeur des préoccupations du gestionnaire, tant l’attachement à la terre peut être fort. Ici, la concertation n’a pas spécialement désamorcé de futurs conflits mais a très largement facilité le processus d’acquisition.
 Au-delà des acquisitions, nécessaires, la concrétisation du processus de création, et son acceptation locale sans opposition majeure, a résulté de la capacité des futurs gestionnaires à n’oublier aucune partie-prenante en amont – principalement les usagers ayant une activité économique susceptible d’impacter ou d’être impactée par la RNR. Un projet de RNR fait assez systématiquement émerger des positionnements de la part des acteurs du territoire. Les opposants, tout comme ceux qui adhèrent au projet, expriment leurs convictions parfois avec force et de manière revendicative. Le rôle des gestionnaires est donc de rencontrer l’ensemble de ces parties et de savoir faire preuve d’une capacité d’écoute, et de fortes convictions, pour ensuite proposer des compromis équilibrés susceptibles d’assurer la pérennité des richesses biologiques tout en apportant une certaine satisfaction aux acteurs économiques.
Au-delà des acquisitions, nécessaires, la concrétisation du processus de création, et son acceptation locale sans opposition majeure, a résulté de la capacité des futurs gestionnaires à n’oublier aucune partie-prenante en amont – principalement les usagers ayant une activité économique susceptible d’impacter ou d’être impactée par la RNR. Un projet de RNR fait assez systématiquement émerger des positionnements de la part des acteurs du territoire. Les opposants, tout comme ceux qui adhèrent au projet, expriment leurs convictions parfois avec force et de manière revendicative. Le rôle des gestionnaires est donc de rencontrer l’ensemble de ces parties et de savoir faire preuve d’une capacité d’écoute, et de fortes convictions, pour ensuite proposer des compromis équilibrés susceptibles d’assurer la pérennité des richesses biologiques tout en apportant une certaine satisfaction aux acteurs économiques.
En Brenne, l’un des enjeux économiques forts reste le maintien d’une activité agricole pérenne qui tend à disparaître au profit de territoires de chasse fermés. Cette activité d’élevage est aussi le seul moyen d’entretien des paysages bocagers typiques de la région. Les gestionnaires ont fait le choix de s’appuyer sur des éleveurs locaux pour entretenir les prairies. Et, plutôt que de ne travailler qu’avec un seul exploitant, il a été décidé de partager l’espace entre six éleveurs. Ces derniers sont par ailleurs concertés pour le choix des poses de clôtures ou encore les projets de sentier de découverte de la réserve naturelle, par exemple. Il est essentiel de souligner, encore, que l’une des exploitantes a participé à l’acquisition d’une partie des terres, en 2012, et a intégré certaines parcelles dans le périmètre de la RNR.
La Brenne est également une terre de pisciculture et cette activité souffre de réelles difficultés économiques. Dans ce contexte, l’impact du Grand cormoran est loin d’être négligeable et les demandes d’une partie de la profession piscicole vis-à-vis de la régulation de l’espèce au sein du territoire préservé étaient exprimées avec force. Les gestionnaires n’ont pas fui la discussion, voire la confrontation, et ont cherché à trouver des modalités d’intervention concertées en assumant le fait qu’il était difficile de laisser l’espèce s’installer au coeur de la RNR. Pour une structure de préservation du patrimoine naturel comme le Conservatoire, envisager de procéder à des tirs d’espèce protégée a généré des débats internes profonds ainsi que des tensions externes avec d’autres protecteurs de la nature. Sans pour autant composer avec ses convictions, le Cen a cherché à définir des interventions strictement limitées et encadrées. Leur application, en association avec le Syndicat des exploitants piscicoles de Brenne, ayant drastiquement réduit les stationnements de l’espèce, l’acceptation locale du projet de création de la RNR n’en a été que facilitée.
Une autre problématique posée au sein du territoire est la prolifération des grands cervidés et du sanglier, causant des dégâts aux prairies et aux clôtures des exploitants. Plutôt que de recourir à des battues administratives, le choix du Cen, ici, a été de s’associer et de louer la chasse à une équipe locale, en limitant l’activité stricto sensu aux seuls cervidés et sangliers, et en excluant les zones d’eau libre. Ce choix, pas forcément bien accepté par les naturalistes mais assumé par le conseil d’administration du Cen Centre-Val de Loire, a toutefois pesé dans l’intégration positive de la RNR au territoire, comme en témoigne le maire de Rosnay (ci-dessous).
Imposer une démarche, ignorer les réalités territoriales en s’appuyant uniquement sur les textes qui régissent les créations d’espaces protégés est réellement contre-productif. C’est la recherche d’un équilibre qui doit guider les structures impliquées dans ces créations, partant du principe qu’il n’est jamais vain de désamorcer dès le début plutôt que d’avoir à déminer par la suite.